

 Blog note de
Blog note de
Papy Larue
Quand notre nouveau pote M LARUE nous a proposé une série sur les noms de rues pour éduquer nos potes âgés et leurs choupinets..
On s’est dit :
« Avec un nom comme le sien…. il est né pour ça..! » personne n’a osé le mettre à la rue car il y était déjà .. En plein reportage dans la rue du 4 septembre
Combien de matelots combien de capitaines…
GPS en main égrainent des noms de rues sans savoir de quoi ou de qui ils parlent…! Et restent penauds dans leurs gouffres amers.
Aidons les à savoir qui sont ces personnages ….
Car celui qui a donné son nom à une rue parle encore comme Tristan Bernard :
“Donner son nom à une rue ou à une route, quel puissant stimulant pour encourager les jeunes gens à bien faire !
De Tristan Bernard / Compagnon du Tour de France – 1935


|
Aujourd’hui :
PLACE VENDÔME PARIS
|

La place Vendôme est un espace public, situé dans le 1er arrondissement de Paris.
Typique de l’urbanisme classique français, c’est une des places de Paris les plus célèbres et considérée comme l’une des plus luxueuses du monde.
Avec la place des Victoires, la place de la Concorde, la place des Vosges et la place Dauphine, elle est l’une des cinq places royales de la ville.
 Par Yair Haklai — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
En cette période de commémorations napoléoniennes du 200ème anniversaire de la mort de l’empereur nous nous intéresserons à la colonne qui orne cette place
|
 Napoléon, souvent représenté dans ses portraits officiels sous les traits d’un empereur romain admirait évidemment « César, Octave (Auguste), et les meilleurs empereurs: Trajan, Dioclétien, Constantin, Justinien« , dont « il se sentait l’imitateur mais aussi l’héritier« .
Napoléon, souvent représenté dans ses portraits officiels sous les traits d’un empereur romain admirait évidemment « César, Octave (Auguste), et les meilleurs empereurs: Trajan, Dioclétien, Constantin, Justinien« , dont « il se sentait l’imitateur mais aussi l’héritier« .
Durant l’occupation de ROME par ses troupes de 1809 à 1814, il envisagea de déménager à Paris la colonne de Trajan, mais il finit par trouver une solution bien plus simple: une copie en bronze!
« La colonne de la place Vendôme, que Napoléon a fait ériger après la victoire d’Austerlitz de 1805 et qui a été inaugurée en 1810, n’est rien de plus qu’une copie de celle de Trajan« ,
Contrairement à la colonne de Trajan, qui a perdu la statue en bronze doré de l’empereur qui la couronnait aux origines, celle de la place Vendôme est toujours surmontée aujourd’hui d’un « Napoléon en César« , avec force toge, glaive et couronne de laurier.
|
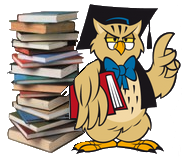 NAPOLEON fit restaurer les monuments de l’empire romain Première bénéficiaire de ce mécénat intéressé, la célèbre colonne de Trajan, édifiée pour glorifier la conquête de la Dacie (l’actuelle Roumanie) par cet empereur qui régna de 98 à 117. NAPOLEON fit restaurer les monuments de l’empire romain Première bénéficiaire de ce mécénat intéressé, la célèbre colonne de Trajan, édifiée pour glorifier la conquête de la Dacie (l’actuelle Roumanie) par cet empereur qui régna de 98 à 117.
|
« Les travaux autour de la colonne de Trajan ont été parmi les premiers choisis par le gouvernement de Napoléon », ….. « la colonne se présentait à l’arrivée des Français comme enfermée à l’intérieur d’un fossé malodorant rempli d’ordures dans une situation indigne d’un monument aussi important ».
« Ces travaux prévoyaient de dégager la zone au sud de la colonne pour créer une grande place (…) Les travaux se poursuivirent jusqu’en 1814, quand les Français durent partir de Rome, et continuèrent au retour du pape Pie VII qui les porta à leur terme ».
|
 Par Arnaldo Mira — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, La colonne célèbre les victoires de l’empereur sur les Daces au cours de deux campagnes militaires (101-102; 105-106), celles que racontent la frise historiée qui s’enroule sur le fût de cette colonne de 38,87 mètres de haut que prolongeait une statue en bronze de Trajan haute entre 4 et 6 mètres. Une statue de saint Pierre la remplace depuis 1587.
Sur la spirale longue de 200 mètres, 2639 personnages d’une extrême variété, 326 représentations d’architecture, 58 tentes, 105 arbres, 82 chevaux…
Depuis sa dédicace, la colonne émerveille tout visiteur qui se rend à Rome et interroge architectes et historiens.
|
 La colonne Vendôme :
La colonne Vendôme :
Une colonne pour la Grande Armée
Sacré Empereur des Français le 2 décembre 1804, Napoléon Ier rentre victorieux de sa campagne militaire d’Allemagne de 1805 : il y a remporté la bataille d’Austerlitz le 2 décembre (un an jour pour jour après son sacre !), contre l’Empereur d’Autriche François Ier et le Tsar Alexandre Ier.
En janvier 1806, il décide de consacrer la colonne de la place Vendôme à sa Grande Armée. Elle doit être construite avec le bronze des canons pris à l’ennemi.
Une bande dessinée en relief de 220 mètres de long !
Napoléon Ier charge son directeur du Musée Napoléon, Vivant Denon, de diriger l’ensemble du projet. Les architectes imaginent une colonne haute de 44 mètres, constituée d’un fût en pierre sur lequel sont fixées des plaques de bronze. Au nombre de 425, elles s’enroulent en spirale jusqu’aux pieds de la statue
 L’exécution est confiée à une équipe d’une dizaine de sculpteurs.
L’exécution est confiée à une équipe d’une dizaine de sculpteurs.
Trois statues pour un symbole historique
On représenter Napoléon en empereur romain, le front ceint d’une couronne de lauriers, tenant dans sa main gauche une Victoire ailée, dans sa main droite un glaive baissé. La colonne est inaugurée le 15 août 1810,
En 1814 quand Napoléon abdique et part en exil sur l’île d’Elbe. La statue est alors descendue par les vainqueurs, et remplacée en haut de la colonne par un drapeau orné d’une fleur de lys : c’est le symbole du roi Louis XVIII et du nouveau régime, la Restauration (1814-1830).
 Le roi Louis-Philippe décide en 1831 l’installation d’une nouvelle statue de Napoléon.
Le roi Louis-Philippe décide en 1831 l’installation d’une nouvelle statue de Napoléon.
C’est le Napoléon en « petit caporal », le chef proche de ses soldats à qui il tirait l’oreille pour les complimenter de leur courage !
Napoléon III fait remplacer en 1863 la statue par une nouvelle version de Napoléon Ier en Empereur romain,
Et la colonne tomba…
En 1870, l’Empire de Napoléon III est vaincu par les Prussiens. L’année suivante, en 1871, une partie de la population parisienne se soulève c’est la Commune,.

Chute de la colonne, le 16 mai 1871, photo par François Franck CC Metropolitan Museum of Art, New York
Le 12 avril 1871 on décide la destruction de la colonne Vendôme, le « symbole de force brute et de fausse gloire ». Le 16 mai, le monument est scié à la base et s’effondre devant une foule nombreuse.
Avec la fin de la Commune, le nouveau gouvernement décide que la colonne sera réparée et relevée, ce qui est fait le 28 décembre 1875.
La colonne Vendôme est classée au titre des Monuments Historiques depuis le 31 mars 1992.
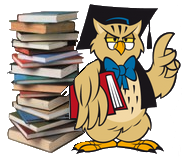 EN SAVOIR + EN SAVOIR +
Une des plus belles vues de Paris
La colonne Vendôme repose sur un piédestal orné de bas-reliefs aux motifs guerriers. Il cache un escalier intérieur de 176 marches qui conduit tout en haut du monument, au pied de la statue de Napoléon, offrant une des plus belles vues de Paris.
 L’affaire Gustave Courbet L’affaire Gustave Courbet
Le peintre Gustave Courbet, fervent Communard, avait lancé l’idée de la destruction de la colonne Vendôme. Après la chute de la Commune, il est condamné en 1873 à payer la restauration de la colonne. Mais il meurt le 31 décembre 1877 avant d’avoir versé le moindre centime. |
 Comment la statue de Napoléon en « petit caporal » est-elle arrivée aux Invalides ? Comment la statue de Napoléon en « petit caporal » est-elle arrivée aux Invalides ?
Lors de la capitulation de Napoléon III en 1870, des Parisiens décident de déplacer la statue pour la cacher. Transportée sur la Seine, elle tombe dans le fleuve, mais est repêchée et conservée plusieurs années dans des entrepôts à Paris. Elle est installée le 11 mars 1911 à l’hôtel national des Invalides, |
 SOURCES :
SOURCES : 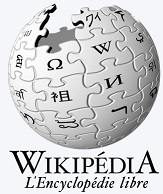 https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/napodoc/monuments-napoleoniens-la-colonne-vendome-paris/
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/napodoc/monuments-napoleoniens-la-colonne-vendome-paris/
https://www.lefigaro.fr/histoire/2015/12/18/26001-20151218ARTFIG00127-les-secrets-de-la-colonne-trajane.php
 A partir des clichés de la colonne trajane pris en 1862 sur ordre de Napoléon III, jamais publiés, l’auteur s’est attelé à une reconstitution minutieuse des scènes de cette colonne qui représentent les célèbres guerres daciques menées par l’empereur Trajan. Une présentation unique dans l’histoire de l’art qui permet d’expliquer en détail les éléments sculptés et donne à voir ce chef d’œuvre des guerres romaines comme personne ne l’a encore vu. A partir des clichés de la colonne trajane pris en 1862 sur ordre de Napoléon III, jamais publiés, l’auteur s’est attelé à une reconstitution minutieuse des scènes de cette colonne qui représentent les célèbres guerres daciques menées par l’empereur Trajan. Une présentation unique dans l’histoire de l’art qui permet d’expliquer en détail les éléments sculptés et donne à voir ce chef d’œuvre des guerres romaines comme personne ne l’a encore vu. |
|

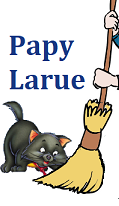 PAPY LARUE
PAPY LARUE

 Coucou c’est toujours moi merci d’être revenu nous voir pour nous suivre dans la découverte d’un tableau plein d’émotion:
Coucou c’est toujours moi merci d’être revenu nous voir pour nous suivre dans la découverte d’un tableau plein d’émotion:![]()
 Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya, né le à Fuendetodos, près de Saragosse, et mort le à Bordeaux, en France, est un peintre et graveur espagnol.
Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya, né le à Fuendetodos, près de Saragosse, et mort le à Bordeaux, en France, est un peintre et graveur espagnol. Dans la nuit du 2 au les soldats français — en représailles à la révolte du 2 mai — exécutent les combattants espagnols faits prisonniers au cours de la bataille.
Dans la nuit du 2 au les soldats français — en représailles à la révolte du 2 mai — exécutent les combattants espagnols faits prisonniers au cours de la bataille.« Le peuple de Madrid abusé s’est laissé entraîner à la révolte et au meurtre » note le Joachim Murat, chef des armées de Napoléon en Espagne.
![]()
![]()














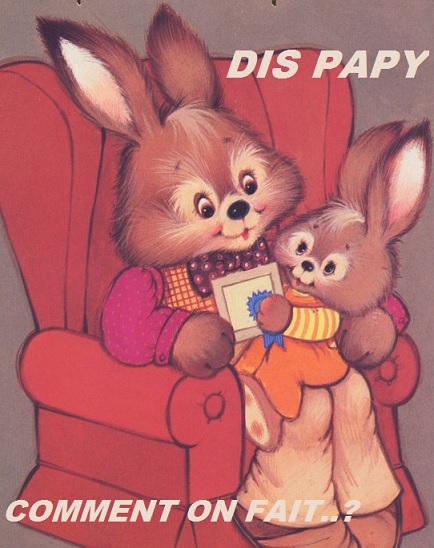





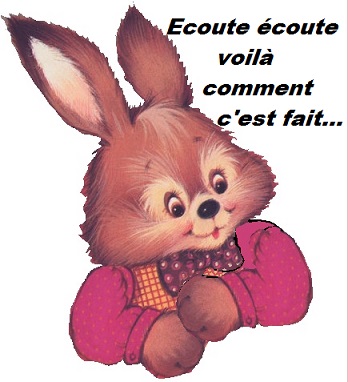








 Napoléon, souvent représenté dans ses portraits officiels sous les traits d’un empereur romain admirait évidemment « César, Octave (Auguste), et les meilleurs empereurs: Trajan, Dioclétien, Constantin, Justinien« , dont « il se sentait l’imitateur mais aussi l’héritier« .
Napoléon, souvent représenté dans ses portraits officiels sous les traits d’un empereur romain admirait évidemment « César, Octave (Auguste), et les meilleurs empereurs: Trajan, Dioclétien, Constantin, Justinien« , dont « il se sentait l’imitateur mais aussi l’héritier« .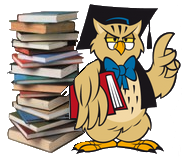

 La colonne Vendôme :
La colonne Vendôme :



 Comment la statue de Napoléon en « petit caporal » est-elle arrivée aux Invalides ?
Comment la statue de Napoléon en « petit caporal » est-elle arrivée aux Invalides ?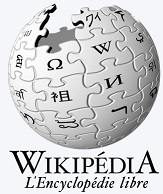

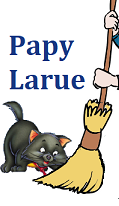 PAPY LARUE
PAPY LARUE